Chronique historique
par Sylvain Bertoldi, conservateur en chef des Archives d'Angers
Vivre à Angers n° 299, mars 2006
Souvent apparaît, sur d’excellentes photographies noir et blanc, une petite estampille ronde, « Cliché J. Evers » : la signature du plus entreprenant des photographes d’Angers dans la première moitié du XXe siècle. Laissons-le parler…
Je suis né le 25 août 1879 à Paris, rue Saint-Honoré. Mon patronyme vient-il de ma grand-mère anglaise ? Abandonné par ma mère, je suis élevé par mon père, un écrivain qui fréquente Théophile Gautier et Gérard de Nerval. Vers 1882, nous quittons Paris pour Nîmes, mais mon père meurt quelques années plus tard. Je suis repris par ma mère, mariée entre-temps avec un toulousain qui ne rêve que théâtre. On m’embarque pour les tournées.
Ma mère a quatre frères, tous photographes, un métier assez nouveau. L’aîné, Edmond Cauville, me prend en charge à Angers et m’enseigne son art. Il produit de merveilleux clichés en couleur et fait d’amusantes photos en surimpression. Quant à moi, je commence ma collection personnelle de clichés stéréoscopiques. Je suis les cours du maître Brunclair à l’école des beaux-arts et fais la connaissance de mon ami Charles Berjole avec qui je travaillerai souvent. Nous nous mettons en société en 1901 après avoir racheté l’atelier d’Eugène Réveillard, 28 boulevard de Saumur.
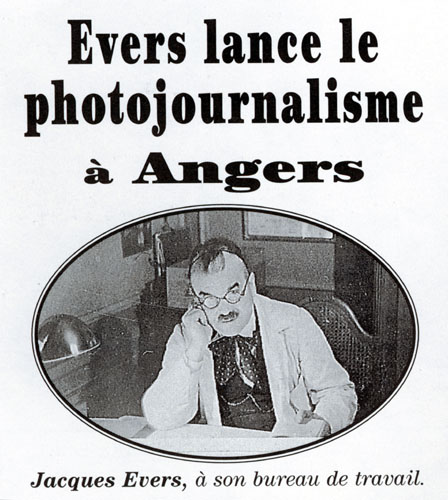
Photojournalisme
19 mai 1906 ! Un grand jour : j’épouse Marie Astier, originaire du Bourbonnais. Elle a l’air d’une fée, dans sa robe de mousseline. Nous avons très vite un fils, puis une fille. Un an après, troisième enfant. Hélas, la méningite l’emporte à deux mois. Pour améliorer nos revenus, je quitte l’atelier de mon oncle et deviens reporter-photographe du « Petit Courrier ». En 1911, avec Duvivier, je lance l’atelier de photogravure du journal et la même année, une revue mensuelle littéraire et historique, « L’Anjou illustré ». Marie se met aussi au travail et prend une librairie 21 rue Voltaire qui devient rapidement le dernier salon où l’on cause. Artistes et écrivains s’y donnent rendez-vous. Elle est si belle et spirituelle ; et grande est sa connaissance des livres.
Les débuts de l’aviation me passionnent, avec les premières courses : premiers vols de René Gasnier en septembre 1908, première course aérienne de ville à ville le 6 juin 1910 (Angers-Saumur), premier grand prix de l’Aéro-Club de France en juin 1912. Et j’aurai mon baptême de l’air en 1919 ! Je m’intéresse aussi à l’automobile, mais lors du circuit d’Anjou de 1914, un bolide rentre dans la foule. Je suis blessé à une jambe et découvre que je suis atteint d’une terrible maladie, l’ostéomyélite, dont les rechutes paralyseront mon activité à plusieurs reprises.
Rue Saint-Denis
Quand Edmond regagne Paris pour plaire à son épouse, je décide de créer ma propre affaire de photographie. Je vends la librairie et aménage mon nouveau commerce en mars 1913 dans une maison du XVIIIe siècle, ancien presbytère de la paroisse Saint-Denis. Je fais construire dans la cour un magasin et une galerie surmontés d’un grand atelier vitré, qui ouvre rue Saint-Denis. Les affaires démarrent bien, mais les frais d’installation sont très lourds. Un ami se défile et je suis obligé de déposer le bilan en juillet 1913. J’ai toujours eu la conviction qu’on voulait d’un trait de plume supprimer ma concurrence trop dynamique. Heureusement, j’obtiens un concordat et paie toutes mes dettes.
 , Ouvre une nouvelle fenêtre
, Ouvre une nouvelle fenêtre
En 1914, pas moyen de m’engager, je suis Anglais pour les Français et Français pour les Anglais ! Nous travaillons jour et nuit pour livrer en quelques heures les photos aux familles des poilus. À nouveau se manifeste la terrible maladie : je dois être trépané à Paris et sans anesthésie… Le chloroforme me rend si malade. C’est très douloureux.
Un travail fou
De retour à Angers, j’ajoute à mon commerce une petite industrie, observée à Paris : la photogravure, où j’aurai jusqu’à quarante ouvriers. Toute la maison de la rue Saint-Denis est envahie par les machines… Mais il est difficile de recruter des ouvriers qualifiés, malgré l’intéressement à l’entreprise que je leur donne en 1925. Il faut les chercher en Angleterre. Marie et moi avons un travail fou ! Le surmenage me rend irascible et je dois me résoudre à vendre mon affaire à l’éditeur parisien Quillet. Je développe alors la photographie publicitaire. La maison de la rue Saint-Denis est de nouveau consacrée à la photographie, d’autant que mon fils Jean se prépare à devenir photographe lui aussi.

Impossible tout de même de se contenter d’un seul magasin… qui marche tout seul. Je lance une succursale à La Baule – dans une rue neuve derrière le casino. Et le surmenage recommence, entre les deux villes. Six ans, nouvelle crise. Cette fois, ma cicatrice ne se refermera pas, il faudra la cacher avec un petit bonnet de taffetas noir. Pendant ma convalescence, la sonnette du cinéma « Le Palace » me donne l’idée de développer le cinéma d’amateur, lancé par Kodak. J’acquiers pour cela un petit magasin au 16 rue d’Alsace. Là, une vitrine animée avec Toto projette des films visibles de la rue, tandis que rue Saint-Denis, au grand magasin dirigé par mon fils, sont exposés mes portraits au charbon, sépia…
3 avril 1946. Marie, mon soleil rayonnant, disparaît. J’arrête ma collection de photographies stéréoscopiques.
Jacques Evers meurt le 22 avril 1969.
Article rédigé d’après les souvenirs de Suzanne Millot,
fille de Jacques Evers (André Tollin, Une vie, Angers, Siraudeau, 1989, 69 p.) et les archives municipales.
